La ville contre l’urbain ?
Le phénomène de développement urbain que nous vivons défie la définition traditionnelle de la ville, sa quadrature, son identité. À le décrire, on pourrait même douter de quelque chose comme la permanence de « la ville ». Et pourtant ce quelque chose ne résiste-t-il pas ?
S’appuyant sur une histoire de la représentation de l’espace urbain occidental, l’écrivain Claude Eveno, urbaniste et professeur à l’École nationale supérieure de la Nature et du paysage de Blois décrit ce qu’il appelle la « partie de go de la ville contre l’urbain » (Histoires d’espaces, 2012).

Le périurbain en débat
L’élection présidentielle a mis en lumière un espace social périurbain méconnu ou mal connu, sur lequel le jugement des journalistes comme des chercheurs était très contrasté. Ce débat témoigne-t-il à sa façon d’un conflit larvé au cœur de la ville contemporaine ?
Le sociologue Éric Charmes, directeur du laboratoire de recherches interdisciplinaires Ville-Espace-Société à Lyon, et auteur de La ville émiettée (2011), qualifie la périurbanisation et défend sa thèse sur la « clubbisation de la vie urbaine ».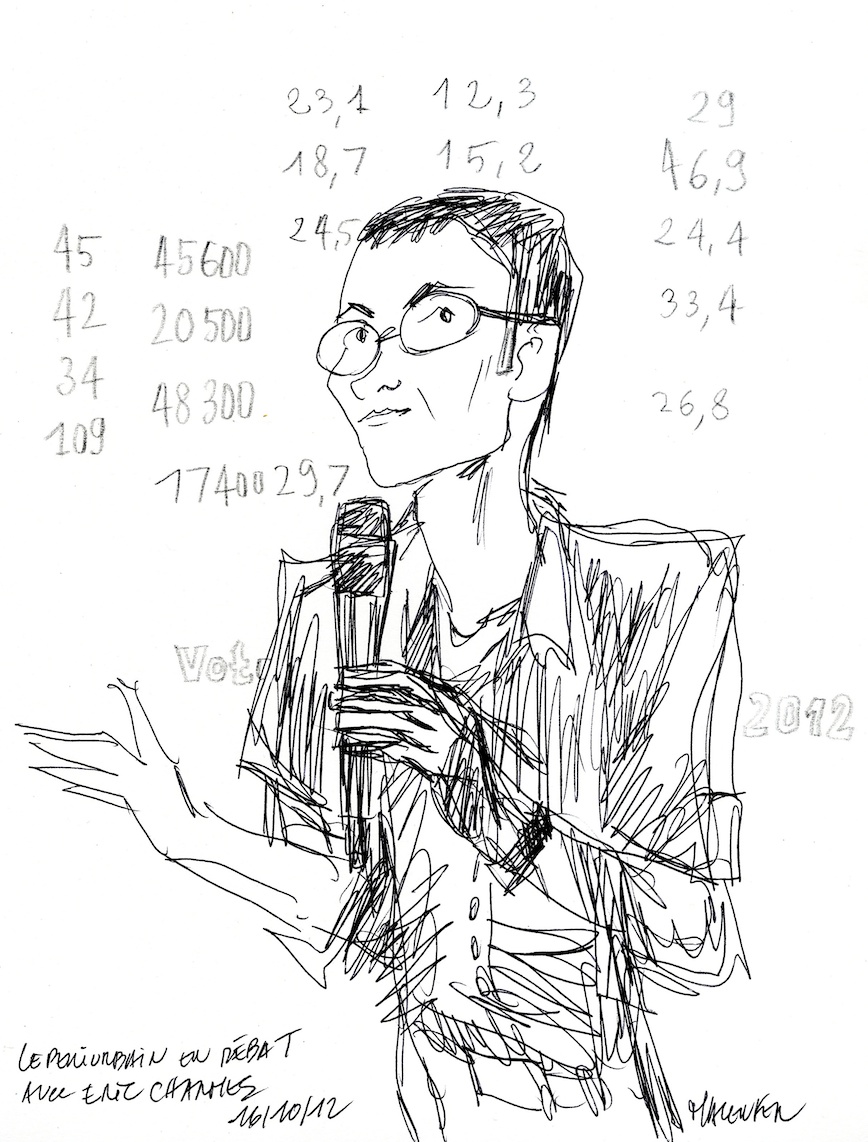
La ville, miroir de l’identité
Dans sa définition même, la ville est un espace de sédentarisation. Habiter la ville, c’est éprouver à sa façon ce qui y fait du lien et ce qui sépare les choses et les êtres. Résider ou flâner, c’est faire l’expérience de l’hétérogénéité de l’espace urbain et donner un sens inédit à cette diversité sensible, par une énonciation toujours singulière.
L’historienne et anthropologue Régine Robin brosse le portrait de cette présence à l’espace urbain.
L’architecture devant l’illimité
Des discontinuités et de la connectivité de point à point de tous les espaces : tel est l’étrange mariage des grandes aires urbaines. Espèces d’espaces échevelés dont la logique se perd… Comment l’architecture, qui est un art réglé et mesuré de l’espace et du temps, peut-elle affronter cette nouvelle ère générique de la ville contemporaine, qui contredit toute harmonie ?
L’architecte Antoine Grumbach, Grand Prix de l’urbanisme 1992 et professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, parle des tiers espaces de la ville et de l’échelle du grand paysage.
Claude Eveno — Oui, procéder à partir des images, c’est un peu une constante chez moi. Ma réflexion rêveuse s’enclenche à partir des images. Dans mon ordinateur en ce moment, j’ai 80.000 peintures, enfin, leur reproduction bien sûr. Le dernier livre sur lequel j’ai travaillé consistait à choisir d’abord 1000 de ces peintures, chacune d’un peintre différent, et à écrire à partir de ce choix. Une peinture en amène une autre, et il en va de même pour l’écriture. Ce n’est pas de l’histoire de l’art, ni un exercice de pensée en compagnie des œuvres d’art. C’est cueillir leur leçon, faire des représentations picturales une gigantesque matière pour penser. J’enseigne dans une École de la Nature et du Paysage. Je m’y intéresse beaucoup à l’histoire des jardins et des théories du paysage et essaye d’y intéresser les étudiants. Les représentations picturales mais aussi écrites sont fondamentales pour bien pénétrer cette histoire. La description que Pline le Jeune donne dans ses Lettres des jardins de sa villa en Toscane est précieuse. On y lit une pensée de la distance, de la profondeur. Ce qu’on voit aussi dans les jardins romains des peintures murales, bien avant l’invention de la perspective linéaire, avec un étagement de certaines couleurs. La profondeur dans la peinture chinoise, c’est un étagement des vides et des pleins. Il n’y a pas d’instrument perspectif, mais des noirs profonds et des gris du papier. En regardant les peintures, en éprouvant leur signification, on entre dans le passé comme dans l’ailleurs.
Urbain, trop urbain — Qu’est-ce qu’une pensée du paysage peut nous enseigner, une fois qu’on a compris qu’il n’y est pas uniquement question d’espace ?
Claude Eveno — Je me suis intéressé au paysage dans les années 1970 grâce à une commande d’étude sur l’architecture balnéaire en France. En étudiant les catalogues qui vantaient ces résidences de bord de mer au XIXe siècle, je me suis rendu compte que le programme de l’architecture balnéaire n’était autre que la réduction du programme du jardin anglo-saxon. On trouve à échelle réduite le tracé, le parcours, la folie et même le château. À partir de ce moment, j’ai commencé à cultiver une curiosité réelle pour le jardin et le paysage. Les paysagistes ont une culture urbaine à transmettre. J’aime leur capacité à appréhender le grand lointain, tant sur le plan théorique qu’esthétique. Ça me fait penser à la vue de Versailles par Pierre Patel (1668), cette façon saisissante dont la ligne fuyante du jardin en vient à se fondre avec la totalité d’un pays. À chaque époque, faire un jardin c’est produire une pensée du monde. C’est pareil pour tout espace public, même pour les « modernes », comme on le voit en lisant Carl Schorske à propos de Vienne. Quelqu’un comme Le Nôtre à l’époque de Versailles avait un pouvoir démiurgique. Aujourd’hui, on doit nécessairement travailler sur les consensus et se demander ce que co-habiter veut dire. Fabriquer de l’espace public, c’est prendre en compte le frottement entre les êtres. Quand il s’agit de réaliser un parc, on se questionne sur les conflits d’usages : on cherche le frottement, pas la guerre. Cela a de multiples incidences, tant dans l’interprétation de la commande, que dans l’expression symbolique de la nature, la recherche d’une civilité contemporaine, la place de l’écologie, etc. La contrainte sollicite un génie inventif.
Urbain, trop urbain — Avec le désir de provoquer un peu, nous avons titré votre intervention « La ville contre l’urbain ? », avec toute l’importance que prend ce point d’interrogation. Car vous n’avez pas précisément un regard négatif sur l’urbanisation contemporaine…
Claude Eveno — Parfaitement. Ça a du bon de donner, encore une fois, un coup de rétroviseur dans l’histoire de la ville occidentale. Lorsque le Baron Haussmann en a terminé avec Paris, la crise aidant, c’est tout de même 60% de la ville qui a changé de physionomie. Imaginons le sentiment de perte sensible que ça a été chez les contemporains ! Force est de constater que ça a été assimilé et que le changement d’échelle de la ville, loin d’entraîner une déroute, a débouché sur de nouvelles caractérisations de l’espace, un nouvel imaginaire qui n’existait pas dans la ville médiévale. Je crois qu’il faut avoir cela en tête lorsqu’on prête trop le flanc à la dramatisation du changement urbain. Il faudrait demander à Régine Robin, que vous invitez aussi à Toulouse, ce qu’elle pense des potentialités de plaisir qu’il y a dans cet urbain contemporain, à l’aune de l’intensité qui peut être celle du rapport à la ville Haussmannienne… Ce qui est passionnant dans l’œuvre de Régine Robin, c’est qu’elle n’est pas seulement une universitaire, qui analyse et étudie en détail son terrain, c’est aussi une littéraire qui a un rapport romanesque à la ville. Elle perçoit des chances futures de la ville, et elle en profite déjà d’emblée, car elle a l’esprit libéré de la critique dominante. On l’aura compris, je ne suis pas d’accord avec cette notion de « non-lieu » qu’on plaque sur certains espaces : cela relève pour moi d’un jugement de valeur et ne va pas plus loin. Même la pensée qui cherche toujours une « fondation », ne pose pas une telle partition territoriale. Un lieu, c’est une manière d’être ensemble. Ce qui a fait lieu peut toujours relever d’un partage symbolique. Et on ne cesse pas de fabriquer des lieux. On ne peut donc pas dire que théoriquement tout est fichu avec la ville postmoderne ! L’urbain se fabrique de manière plurielle. C’est ce qu’on redécouvre. Les théories modernes de Le Corbusier et ses héritiers participaient d’une haine terrible de la ville. Et les Trente glorieuses ont donné à la technostructure un pouvoir considérable au prétexte d’aménager le territoire et de le doter en équipements stratégiques. Ce modèle est révolu. Mais nous en héritons, en matière de ségrégation des espaces d’habitat social et de primat donné à la circulation. On ne demandait pas au créateur d’autoroute de penser au plaisir d’être en ville. Encore maintenant, on apprend aux ingénieurs des Ponts à travailler sur des fonds de plans où il n’y a pas la moindre représentation de ce qu’il y a réellement en termes de paysage… Le paysage n’existe pas. C’est propre au vingtième siècle, cet aveuglement à l’égard du paysage. Aujourd’hui, on en sort. La ville est un rapport au ciel et à la terre. Ma grande surprise en arrivant à Tokyo, c’était le minimalisme de l’éclairage urbain : nous étions de fait dans un rapport à la rue qui n’est pas spectaculaire marchand ; nous étions dans une ville plate à l’intérieur d’une ville verticale. Tout était au niveau du sol, alors que nous savions que de grandes tours étaient là. L’humanisme de l’éclairage était extraordinaire. On peut donc faire de la ville avec de l’architecture gigantesque, et dans le même temps faire de la ville « à l’ancienne » : un palimpseste permanent est possible, y compris dans la folie constructive des mégapoles…
Éric Charmes — C’est l’hypothèse que la structuration institutionnelle du périurbain, et notamment l’émiettement du tissu communal, cumulée aux compétences et aux pouvoirs relativement étendus des édiles, donnent un impact particulier aux dynamiques d’urbanisation qui se manifestent autour des villes-centres. Autant on ne peut pas assimiler une grande ville à un club résidentiel, autant on peut le faire d’une commune périurbaine de mille habitants, où l’urbanisation est quasi exclusivement pavillonnaire et où les propriétaires occupants représentent quelque neuf dixièmes de la population. Or, dans le périurbain, de telles communes sont très nombreuses. En y achetant une maison individuelle, c’est comme si l’on achetait un ticket d’entrée dans un club, un droit d’accès à un environnement social, à un cadre de vie, à des équipements, etc. En d’autres termes, on s’attend à jouir d’un cadre de vie déterminé. C’est cela, la « clubbisation », terme dont je reconnais volontiers qu’il n’est pas très gracieux. Dans l’aire urbaine de Toulouse, que je confesse mal connaître, je pense que les Toulousains identifient aisément les phénomènes dont je parle, il suffit par exemple de traverser les coteaux des territoires du Sicoval et le périurbain au sud-ouest pour le visualiser. Mais il y a à Toulouse des personnes qui parleraient bien mieux que moi de ces territoires. Je pense à Marie-Christine Jaillet bien sûr, mais aussi à Lionel Rougé ou Séverine Bonnin-Oliveira, qui vient de soutenir une thèse sur le périurbain toulousain. Autour de cette idée de la clubbisation, j’aborde diverses questions dans le sillage de mon livre, La Ville émiettée, à savoir : quels sont aujourd’hui les mécanismes de croissance de la ville ? pourquoi peut-on parler de ville émiettée ? sur quoi repose la typologie qu’on peut brosser des communes périurbaines : les petites du front d’urbanisation, les bourgs centres et les communes résidentielles entrées en clubbisation ? quand et comment celles-ci deviennent-elles des « clubs », à la faveur de quels leviers ? que peut-on dire enfin de la coloration politique du périurbain en se gardant de la caricature ?
Urbain, trop urbain — Il y a une originalité méthodologique de votre œuvre qui consiste notamment dans le croisement entre les études urbaines et la microéconomie : comment en êtes-vous arrivé à ce type de travaux ? L’interdisciplinarité était-elle essentielle au surgissement de vos thèses ?
Éric Charmes — En fait, avant de travailler sur les communes résidentielles du périurbain, j’ai étudié les résidences fermées, qu’on appelle en anglais gated communities. J’avais alors constaté que, dans les périphéries des grandes villes françaises, le phénomène était beaucoup moins développé qu’aux États-Unis par exemple. En France, l’exclusivisme local prenait forme avant tout dans les règlements d’urbanisme municipaux. J’ai donc senti qu’il y avait un rapprochement possible entre les copropriétés pavillonnaires et les petites municipalités du périurbain. Or, lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux gated communities, j’ai fait la connaissance d’un géographe anglais, Chris Webster, qui lui aussi mobilise la « théorie des biens clubs », bien qu’avec une perspective assez différente de la mienne. Quand j’ai lu les travaux de l’économiste Charles Tiebout et ceux des économistes sur les biens clubs, le rapprochement empirique entre les gated communities et les petites communes a alors fait sens : le concept de « club » s’est imposé en tant que grille de lecture théorique du phénomène périurbain qui m’intéressait. Cela a été un travail théorique et long, car il fallait que je me replonge dans la littérature économique pour aller au-delà de l’usage métaphorique de ce concept de club et tirer le meilleur parti des théories économiques qui ont été construites sur lui. L’économie n’est pas la seule discipline que je mobilise en effet. Mon champ de réflexion principal est la géographie et la socio-politique. J’ai par ailleurs beaucoup d’intérêt pour les outils qui qualifient l’espace, pour les règlementations du foncier, et pour l’appareil des documents d’urbanisme… L’idée n’est pas nécessairement de regarder ces objets d’un point de vue critique, mais de voir leurs effets dans la vie concrète des territoires et des gens. Je les considère d’un point de vue pragmatique, au sens philosophique du terme, ce qui revient à savoir quels sont les problèmes que se posent les gens et à décrire les solutions qu’ils trouvent en mobilisant les outils qui sont à leur disposition. Le problème qui m’intéresse plus particulièrement est celui de la territorialisation : comment trace-t-on des limites territoriales entre un intérieur et un extérieur, ou bien comment assure-t-on le contrôle de la fréquentation des écoles ou la maîtrise du cadre de vie ? Il ne s’agit pas tant, au moins dans un premier temps, de poser un regard critique sur ces volontés de contrôle et leurs effets d’exclusion, bien réels, que de savoir comment les personnes font et quelle panoplie d’outils se propose à elles. Les personnes n’utilisent que les outils qui sont accessibles et qu’elles peuvent maîtriser : en France, l’institution communale propose toute une palette d’outils à mobiliser pour qualifier l’espace et l’organiser. Dans d’autres pays, c’est le recours à la copropriété qui prévaut. Ces outils ont un effet sur le territoire lui-même et c’est ce que nous observons au travers de la périurbanisation. Les objets sont bien des actants, pour moi, ils appartiennent pleinement à la chaîne d’action, pour parler comme Bruno Latour. La barrière de la résidence fermée fait partie du dispositif comme les limites de la carte scolaire ou le plan local d’urbanisme. Une fois ces outils mis en place, ils marquent des frontières, et ces frontières à leur tour ont des effets.
Urbain, trop urbain — On a envie de dire pour notre part que la culture de l’espace public des plus urbains de nos concitoyens tend à se fondre avec celle du périurbain, notamment quand les cœurs de ville anciens deviennent des galerie commerçantes à ciel ouvert, des espaces hautement franchisés où l’interaction sociale n’est finalement pas si différente de ce qu’on peut voir dans une grande surface de commune périurbaine…
Éric Charmes — Vous n’êtes pas le seul à dire cela et j’ouvre le propos dans ce sens dans la conclusion de La ville émiettée. La clubbisation est quelque chose que l’on peut retrouver sous d’autres formes. Les résidences fermées on vient de le voir peuvent être considérées comme des petits clubs. Toulouse est d’ailleurs aussi une « championne » des résidences fermées, avec le promoteur Monné-Decroix. Mais cela est bien distinct du périurbain et relève de questions différentes. La clubbisation existe aussi dans les centres-villes, avec cette idée que les gens ont un droit de propriété pas seulement sur leur maison, mais sur leur environnement (défense de la faible densité, des espaces verts, etc.). La « défense » du quartier procède souvent d’intérêts particuliers, comme dans le périurbain. Mais entre les centres-villes et le périurbain, il y a une différence importante, celle de l’échelle de décision. Si l’on raisonne à l’échelle de la ville, on peut avoir des arguments solides à opposer pour faire valoir un intérêt métropolitain. C’est pourquoi il faut bien voir la spécificité de l’organisation institutionnelle de la commune périurbaine, peu peuplée (de l’ordre de mille habitants en moyenne), qui fait prédominer les intérêts résidentiels. Cet effet d’échelle n’existe pas dans une grande ville où l’intérêt résidentiel trouve en face de lui des intérêts différents voire opposés (dont l’économie) : le maire peut se « permettre » de mécontenter un quartier en réalisant son projet urbain. Cet effet de structure invite à bien distinguer ces deux formes de l’urbain. Ce qui est exact en tout cas, c’est que, par ses caractéristiques institutionnelles mais aussi morphologiques et paysagères, le périurbain rend particulièrement visibles des dynamiques sociales qui débordent largement le périurbain et ne lui sont pas propres. Le périurbain montre comment, notamment pour les classes moyennes et aisées, l’ancrage local ne relève plus d’une logique villageoise et communautaire, mais d’une autre logique. Aujourd’hui encore en sociologie, la pensée demeure très structurée par l’opposition entre communauté et société, la solidarité mécanique d’un côté, la solidarité organique de l’autre (pour reprendre le vocabulaire durkheimien). C’est le village contre la ville… Le débat sur le communautarisme le montre, on continue à penser les relations sociales au prisme de cette opposition. Une de mes thèses est que cette opposition est un écran idéologique, qui empêche de voir les dynamiques sociales à l’œuvre. Je l’ai écrit d’ailleurs à propos des gated communities, qui sont présentées souvent comme une opposition à la société. Il suffit d’entrer dans une résidence fermée en France pour se rendre compte que cela n’a rien à voir avec une « communauté ». La gated community est un élément de la société : loin d’être un espace en repli ou en sécession, elle est le produit d’un éclatement des pratiques quotidiennes, des mobilités résidentielles, etc. La ville « franchisée » de David Mangin décrit bien cela. C’est justement parce que la communauté, au sens traditionnel du terme, est introuvable, que l’espace résidentiel n’est plus un espace communautaire, qu’un dispositif technique tel que la barrière apparaît. Le concept de « club » a donc cet intérêt de donner à voir la territorialisation locale autrement que dans l’opposition communauté-société. Ce n’est pas la fin du territoire local, mais ce n’est pas sa résurgence sous des formes traditionnelles non plus. Il y a peut-être un « fantasme villageois », mais ce qui réunit les gens en un espace tel que la commune périurbaine, c’est la jouissance partagée d’un certain nombre de biens et d’aménités. Or ce n’est pas un lien politique (comme dans le village avec sa hiérarchie, ses riches et ses pauvres, ses paysans, ses commerçants, ses notables, dont les relations se régulent politiquement). Ce qu’on voit aujourd’hui comme régulation de l’échelle locale, ce n’est pas le projet partagé, mais l’accès à des biens et donc « l’appartenance » : qui vient, qui ne vient pas, qui fait partie du club ? Dans pareille configuration, les biens et services offerts par le club, ses aménités sont des données, ce ne sont pas des choses dont on débat politiquement… Le problème est alors le transfert du débat politique de l’échelle de la commune à celle de la métropole. Les dispositifs institutionnels adaptés font ici défaut.
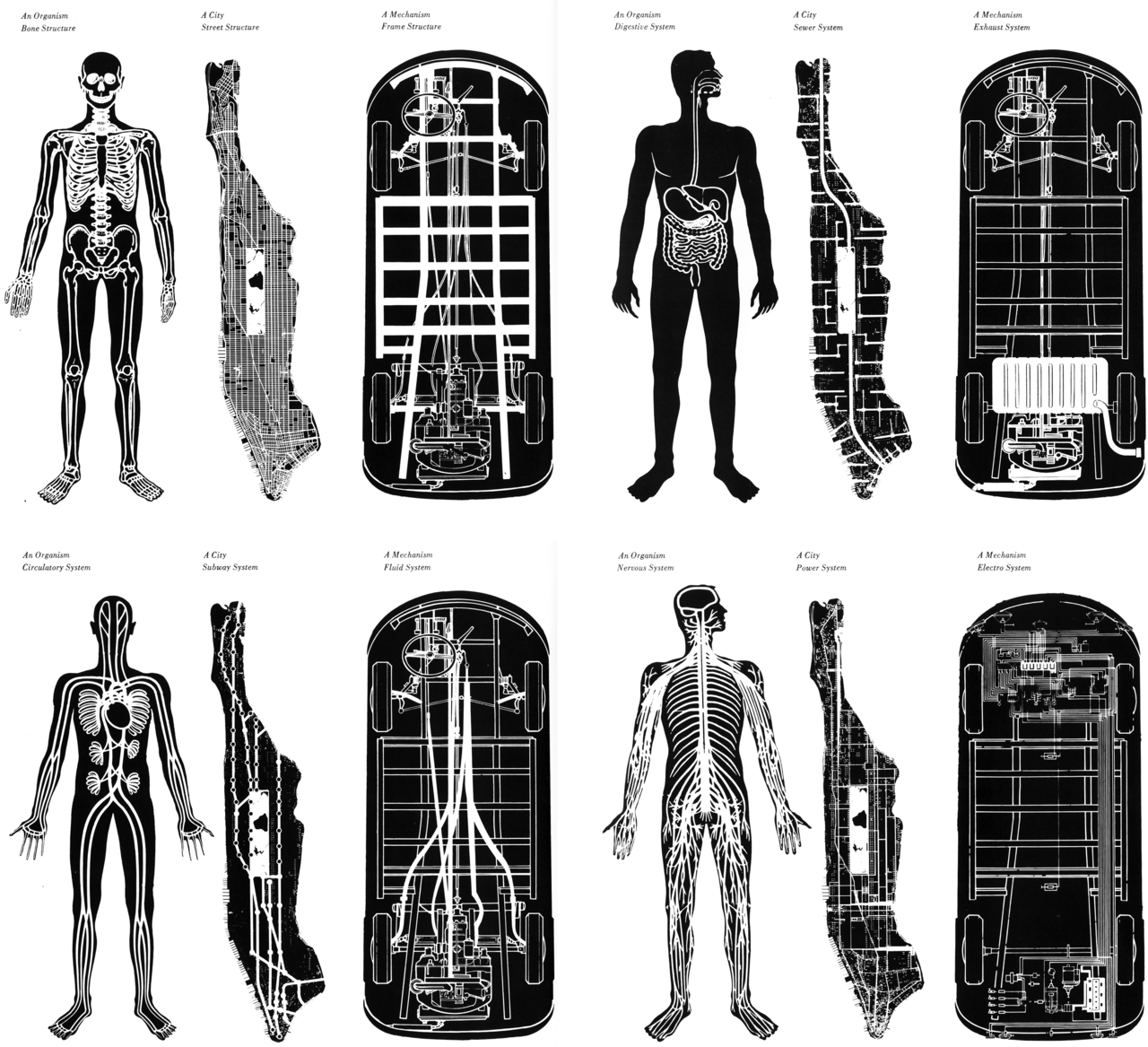
Il faisait gris à la sortie de la Gare Montparnasse, ce “Montparnasse-Monde” que j’avais lu avec délectation chez Martine Sonnet, et je remontai la rue du Départ, puis le boulevard à la recherche d’une brasserie pas trop toc ni trop chic. Je m’assis sur une banquette de vieux cuir adossée à un miroir à moulures, au Sélect précisément. À côté de moi, une dame tenait conversation avec un jeune homme. J’eu le goût d’écouter, car ce que j’en saisi faisait étrangement écho à mes souvenirs de lectures urbaines. Ils ne me remarquèrent pas, voici ce que je glanai. …
Lui ~ … Et Vavin, le Sélect, les cinoches alentour, lorsque vous vivez à Paris?
Elle ~ C’est ici que je donne mes rendez-vous aux amis pour déjeuner. Mon libraire, Tschann, est à côté sur le boulevard Montparnasse. Et oui, les cinémas, je ne pourrais pas vivre sans cinémas autour de chez moi. Il y en a sept rien que de ce côté-ci du quartier, une douzaine à Montparnasse. Dans le coin, là-bas, vous voyez, je prends le 91 plus volontiers que le métro.
Lui ~ Ça vous rappelle les colectivos de Buenos Aires, le bus?
Elle ~ Je les ai passionnément aimés ceux-là, avec leurs robes chamarrées, je les ai pris dans tous sens, au hasard ou de façon systématique, avec une obstination toute méthodologique, si vous voyez ce que je veux dire…
Lui ~ Oui, comme lorsque vous allez à tous les terminus du métro de Londres, les uns après les autres, jour après jour et que cela dure bien un mois, cette histoire.
Elle ~ Exact, parce qu’il me fallait alors trouver une façon de redécouper la mégapole et de venir au contact de sa circonférence. Puisque Iain Sinclair avait parcouru à pieds toute cette orbite périphérique de Londres, la M25, je venais ainsi à sa rencontre avec un autre principe, en étoile depuis le centre, par le subway. Mais pour revenir à Montparnasse, ce quartier cabossé est tout ce dont je me languis quand je ne suis pas en France. Je pense à cette brasserie, à mon immeuble Mouchotte sur la rue du même nom, qui donne ensuite sur l’avenue du Maine, à mes déambulations autour de la dalle de béton, à la gare que peu de gens aiment, à la Tour que Modiano et Paris entier avec lui semblent vomir… Tout cet endroit me réjouit!
Lui ~ Le Vieux Paris vous ennuie?
Elle ~ Tout ce qui prétend fleurer l’authentique m’ennuie. D’abord parce que tout est factice ou artificiel si on y regarde de près. Je suis une enfant de Belleville, j’ai assisté au changement complet de décor de ce quartier, comme à la destruction du “vieux” Montparnasse. Les contemporains du Baron Haussmann déploraient la disparition de leur Paris, Guy Debord et les Situs luttaient contre les assauts des pelleteuses de Pompidou dans le mouchoir de poche de Saint-Germain et de la Contrescarpe, et aujourd’hui, Modiano que je citais à l’instant se voile le visage dès qu’il aperçoit autre chose ici que la brasserie de la Coupole. Sans cesse la ville se construit sur ses ruines et ce à quoi j’aime m’attacher pour ma part ce n’est pas à une façade “d’époque”, mais à la mémoire des lieux, qui est davantage le fait de l’entrelacement des récits, des représentations, des fictions…
Lui ~ Si je comprends bien, tout serait kitsch, la copie comme le modèle, et ce qui compte en revanche ce sont nos appropriations du lieu, qu’elles relèvent des habitudes portées par une existence, ou bien de nos projections fantasmatiques…
Elle ~ Je vais vous raconter une histoire. J’ai passé une fois un séjour à Las Vegas, ville sur laquelle je ne porte pas un regard aussi sévère et attristé que Bruce Bégout, mais c’est encore une autre histoire… Avec une amie, nous avons visité tous les lobbies de ces casinos gigantesques où figure le pastiche qui de Paris, qui du Grand canal de Venise. C’est des plus drôles quand on vous indique que la place Saint Marc se situe à l’étage à droite après l’escalator! Toutefois, au New York-New York Casino, la réplique d’un pâté de rues de Greenwich Village ne collait pas; quelque chose clochait pour nous qui connaissions très bien ce quartier; en somme, nous avons trouvé ce pastiche raté, voire… inauthentique! Sauf que le temps passe et un jour je me rends au “vrai” croisement de rues à Greenwich Village: je reste alors interdite devant ce que je vois, c’était ce quartier qui me donnait à présent le sentiment d’être factice, chiqué, en carton-pâte!
Lui ~ Peut-être parce qu’il y avait comme un épuisement de ce que cet endroit avait à dire? Peut-être que comme dans le Paris de Woody Allen, Greenwich avait trop voulu ressembler à sa carte postale?
Elle ~ C’est cela, et à l’inverse de cette saturation, certains lieux manquent de fiction, manquent de travelling cinématographique ou d’enquête policière. Dans le livre que j’ai en cours sur Paris, j’ai introduit la figure d’un inspecteur de police qui traque un criminel, à seule fin de densifier la description de quartiers tels que la ZAC Masséna, vous savez, autour de la grande Bibliothèque. “Mon” inspecteur visite aussi la Tour Montparnasse et l’immeuble Mouchotte. J’avais besoin de cette fiction pour flâner et renégocier la figure du flâneur dans la ville contemporaine. De même, la petite femme de Snow, la femme sans âge qui se démultiplie, m’a bien été utile dans Mégapolis.
Lui ~ Et la chiffonnière de la rue Rosa Luxembourg dans votre livre sur Berlin?
Elle ~ C’est une pure reconstruction, elle est inventée de toutes pièces pour servir mon propos sur la mémoire. Ce qui me donne d’ailleurs une identité juive-allemande à bon compte, c’est tout de même plus chic que d’être juive de souche polonaise, n’est-ce pas? Mais blague à part, ce que Berlin a signifié à cette époque qui suit la chute du Mur, c’est cet empressement à effacer la mémoire et même à créer ce que j’appelle des lieux de “démémoire”. La chiffonnière est presque une métaphore de Berlin, elle qui revend à son client obsessionnel la moindre trace, le moindre document d’archive permettant d’identifier que son père était nazi, preuves qu’il fait disparaître immédiatement. Un jour, il pense pouvoir dire que ce père n’a pas existé, en tant que nazi du moins… C’est un peu l’histoire du membre fantôme qui vous fait souffrir.
Lui ~ Et une ville peut se jouer à elle même cette histoire?
Elle ~ Oui, une ville peut le faire. C’est ce qui s’est passé à Berlin avec tous ces chantiers qui l’ont métamorphosée jusque dans les années 2000. Reprendrez-vous un café? Je vois que nous en avons encore pour un moment…
… À ce moment précis, un fâcheux m’appela au téléphone et je fus obligé de congédier cette scène amusante. Lorsque je pus à nouveau laisser traîner mes oreilles, ils discutaient de formalités administratives à propos d’une conférence que devait donner prochainement cette dame. C’était sans intérêt et ne mérite pas que je vous le rapporte ici.
Antoine Grumbach — Dès mes années de formation, j’ai marqué une opposition franche au mouvement moderne qui imposait un modèle achevé, « les maisons blanches », et une culture de l’architecture comme art de la fondation. Aujourd’hui que nous voyons des architectures de papier glacé se répéter partout sur la planète et que les espaces « internationaux » sont quasiment identiques dans toutes les villes, la même exigence éthique se formule. Pour fabriquer une ville habitable, il faut de l’hétérogénéité. On ne peut pas vivre dans des cliniques ; et la ville ne saurait se résumer à l’addition d’éléments architecturaux. La ville est cosa mentale. C’est-à-dire que selon moi, les représentations mentales du territoire font aussi la ville, et plus surement que les machines solitaires de l’architecte. Mon travail n’est pas de réaliser des statues esseulées qui se drapent dans leur beauté, c’est de bâtir le socle. L’architecte n’est plus capable de « représenter » quoi que ce soit : s’il veut créer de la différenciation il entre de ce fait dans l’obsolescence programmée des signes. Combien de fois a-t-on entendu parler de Bilbao ? Mais Bilbao se banalise, se reproduit et s’appauvrit. C’est un mouvement nécessairement compris dans l’acte de fondation. Dans les catégories de la beauté que mentionne Ruskin, j’aime assez celle de « sublime parasite ». Je ne considère pas l’architecture comme une œuvre sublime « assemblée sous la lumière », mais comme un collage. C’est un peu comme le lapsus chez Freud : à un moment donné, un acte renvoie à un élément perturbateur, qui était resté inconscient. C’est pourquoi d’ailleurs je ne peux bâtir, en tant qu’architecte, comme s’il s’agissait d’un acte nu. Je compose toujours des fictions narratives et historiques. Car il faut que l’œuvre architecturale soit « ouverte » comme dirait Umberto Eco. Pour le projet du quartier Commercial du Millénaire à Aubervilliers, j’ai procédé ainsi, inventant la généalogie des transformations d’un quartier depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui, et mêlant des architectures différenciées dans un même bâtiment. Un collage à la Kurt Schwitters ! Lequel ne fait qu’attendre des transformations ultérieures.
Urbain, trop urbain — Ce besoin d’histoire et cette nécessité de l’inachèvement que vous revendiquez en matière d’architecture s’appliquent-il à l’urbanisation contemporaine dont on souligne souvent au contraire la nature « générique » ?
Antoine Grumbach — Cette question est importante, car on se voile la face. Peu de monde en effet, notamment parmi les urbanistes, accepte de voir autrement que sous l’angle du jugement de valeur très dépréciatif l’urbanisme diffus et le développement urbain en filament, le long des voies de communication, lequel prend peu à peu une consistance territoriale, comme le montre Hervé Le Bras. Je crois qu’Éric Charmes, que vous invitez aussi à Toulouse, mettra cela en débat, avec le thème du périurbain. Pour moi, en tout cas, ce développement mérite à son tour de nouvelles fictions narratives, mais qui procèdent d’une étude rigoureuse de la situation, bien sûr. J’aime en ce sens appliquer ce que j’appelle la « dialectique des contraintes », c’est à dire chercher les endroits les plus « négatifs » des villes — les recoins abandonnés, les limites communales, les emprises ferroviaires —, et postuler l’avènement de la ville nouvelle à ces endroits, qui subsume le négatif. La croissance radioconcentrique de Paris a provoqué, on le sait, la naissance d’espaces de relégation et de marginalité. On pense aux grands ensembles. Pour ma part, je ne suis pas inquiet à leur sujet, la dialectique des contraintes fera son travail. Mais quelle violence de prétendre qu’il faille « achever les grands ensembles » ! Achever c’est tuer, ça veut dire que plus rien ne peut se passer, c’est contraire au mouvement de la ville. De même que les grands ensembles méritent qu’on se pose la question de leur transformation, de nombreux endroits « négatifs » des villes, en déshérence, sont de fait devenus des « lieux ». Donc la question à se poser est celle de savoir si les métropoles ont une forme. Quel est l’ADN d’une ville, ce qui tient ensemble ses parties ou archipels, de quelle identité non technocratique peut-elle se référer ? Eh bien selon moi, l’ADN ou la matrice des grandes villes tourne souvent autour des variations qu’elles instruisent dans la relation de la nature à l’urbain. « La vraie nature, c’est la fausse », dit Aragon aux Buttes-Chaumont. Que l’on songe à New York, Paris ou Moscou : chacune règle de façon différente ce rapport ; chaque mégapole partage un certain nombre d’aspirations sociales définies à travers l’idée de Nature. J’ai beaucoup écrit sur Alphand et l’embellissement de Paris : le génie de la création des promenades, des parcs et des jardins pour accompagner la transformation considérable de la ville parisienne, ça été d’instruire un rapport à la nature qui est la marque de Paris. Paris est la ville du monde où il y a le plus grand nombre d’arbres rapporté à la population. Pas des surfaces d’espaces verts, mais des arbres. En étudiant Moscou, notre équipe en est venue à l’idée que le trait de cette agglomération, c’est que c’était une ville dans une forêt. C’est très différent.
Urbain, trop urbain — Nous avons souhaité justement que vous nous décriviez ce rapport au grand territoire que vous connaissez bien, ayant participé à la consultation du Grand Paris et à présent lauréat de celle sur le Grand Moscou…
Antoine Grumbach — Je réfléchis effectivement en ce moment — et pour un bon moment ! — au Grand Moscou et à la Moskova. Dans la consultation internationale sur le Grand Moscou, à laquelle j’ai participé avec tout un ensemble de partenaires, Bernardo Secchi a proposé quelque chose d’intéressant sur la notion de magnificence urbaine. Qu’est-ce qui peut fonder l’identité d’une ville ? Secchi a répondu : « Pourquoi pas un immense espace naturel, un parc ? » Personnellement, j’ai considéré les choses différemment et pensé que je devais travailler à Moscou sur la mobilité, et sur la brique de la vie quotidienne qui s’enracine dans des îlots de grandes tailles sur les îlots et sur les infrastructures de transports. Le projet d’agglomération retenu prévoit de renforcer les urbanisations linéaires, maillées par des lignes de métro où se greffent des lignes de tramway. Nous y avons maintenu aussi dans le plan masse — qui est immense, 150.000 hectares de ville nouvelle — ce rapport à la forêt qui est caractéristique de Moscou. Mais tous ces projets d’extension sont indissociables d’une transformation de la ville existante pleine de friches industrielles, ferroviaires et résidentielles. Pour l’invention urbaine, nous avons besoin d’une représentation territoriale qui ne soit pas bornée et limitée par des référents abstraits dictés par les technostructures. Une question première à l’endroit du grand territoire est « y a-t-il une forme ? » En effet, on cherche une représentation collective, une évidence partagée. Il y a de nombreux territoires dont on a beaucoup de mal à saisir l’identité. Peut-on habiter dans ce qu’on ne saisit pas ? D’où le retour à la géographie. J’ai un intérêt immense pour la géographie, que je range dans le répertoire des sciences « réflexives », comme la psychanalyse. Elles ont des objets qu’on ne peut réduire, comme la climatologie d’ailleurs, ou la biologie : ce sont des ensembles sans fin qu’elles parcourent et inventorient, de sorte que ces sciences portent un imaginaire de l’inachèvement qui me convient bien, moi qui suis régulièrement confronté au territoire, c’est-à-dire à un sol, à une géographie et à une histoire. Les grands bassins hydrologiques me fascinent aussi pour cela, car j’estime que ce sont une nouvelle échelle d’appréhension du phénomène métropolitain. Les grandes métropoles se confrontent toujours à des identités géographiques. Ce geste est à rebours de l’utopie détestable des villes nouvelles qui était guidée par la Charte d’Athènes. La ville est, à la différence de l’architecture, en reconstruction perpétuelle : elle ne s’arrête pas, on ne peut la fixer ou la mettre sous cloche.
Les vidéos des conférences
Illustrations des conférenciers par Frédéric Malenfer.

