Le lendemain de la veille urbaine #21: l’inhabitable

Le lundi matin à heure fixe, Urbain, trop urbain donne sous forme de chronique un petit résumé des meilleurs liens glanés sur Internet lors de la semaine écoulée. Le fonctionnement est simple : le taux de consultation des URL diffusées sur notre compte Twitter fait le partage statistique, charge au rédacteur de trouver un fil rouge dans les liens ainsi sélectionnés par cet arbitraire de l’audience…
On me dit qu’une nation existe et puis n’existe plus, qu’un homme trouve sa place et puis la perd,
que les noms des villes, et des domaines, et des maisons, et des gens dans les maisons
changent dans le cours d’une vie, et alors tout est remis en un autre ordre et plus personne
ne sait son nom, ni où est sa maison, ni son pays ni ses frontières. Il ne sait plus ce qu’il
doit garder. Il ne sait plus qui est l’étranger. [1]
Un signal urbain, bâti bien haut pour donner à une ville sa fierté, émet aujourd’hui des signaux de détresse et d’espoir mêlés. Nous sommes à Tokyo, et Pierre Ménard, de Liminaire, vient écrire chez nous « l’arbre des cieux » qu’est cette tour de télétransmission. Tous les écrans du monde « retransmettent » ce qui s’y passe, à Tokyo, et traduisent l’angoisse d’une population ne sachant même plus se recommander en confiance à la terre qui la porte. Où aller ? « Tokyo se pense toujours dans l’après séisme » écrivait encore Pierre ici même. Et en évoquant le travail de l’artiste Nurri Kim — sur ces fameuses bâches bleues de protection dont se servent les sans abris japonais — il notait « la façon dont les japonais s’adaptent intuitivement à une situation donnée, le marquage et la protection de leurs limites, de leur espace vital, dans certaines circonstances », notamment les plus dramatiquement illustratives du fait qu’on a « tout perdu ».
Face à la catastrophe que vivent aujourd’hui les japonais, « Tchernobyl » toujours ressassé est un de ces noms de lieux très étrange, tant par sa capacité à désigner l’absolu néant d’une dépossession de la terre des hommes, que par la charge de fascination dont cet endroit interdit demeure l’objet. L’inhabitable Tchernobyl est un abyme ontologique, une figure urbaine totale — comme l’on dirait d’un « fait social total » — de la destitution.
Il est des villes dont le désir d’homme est ainsi suspendu qu’on ne sait si leur « année zéro » date d’avant ou d’après la catastrophe. Il est des villes qui disent l’obsolescence des espaces urbains avant même d’être achevées. Il est des villes qui sont des ruines modernes d’on ne sait quelle apocalypse. Il est des villes qui sont neuves d’être abandonnées — des cartographies de la désertion.
Occuper une place qui n’est a priori la place de personne, comme devenant sa place — c’est comme changer de nom et s’efforcer de rattacher aux conditions d’incertitudes matérielles et symboliques vécues une forme de construction identitaire. Le mal-logement est comme l’expression euphémisée du mal-être ; il ne définit pas la situation de quelqu’un qui n’a plus de place, mais justement celle de quelqu’un devant habiter l’inhabitable.
Illustrer ? Pas forcément besoin de rappeler ce gratte-ciel prestigieux abandonné en cours de construction, et devenu une ruche d’habitats précaires à Caracas, ou l’immeuble Mercúrio de São Paulo. Je ne vous parlerai pas davantage des cas, déjà décrits ici, de Kowloon Walled City ou de Chungking Mansion, à Hong Kong. Je vous demande plutôt d’aller feuilleter un récent petit livre, L’inhabitable, où est brossé un portrait de l’insalubrité de l’immobilier à Paris aujourd’hui.[2] Les photographies de Jean-Claude Pattacini y ont une sensibilité digne. L’architecte Éric Lapierre y résume l’instructive histoire de la catégorisation de la salubrité de l’habitat, décrivant notamment le plan Lopez de 1957.
Bien sûr, les activités humaines génèrent de l’inhabitable. De façon structurelle, le phénomène urbain ne produit pas seulement de la ville générique à l’endroit de laquelle on peut douter de la permanence de « la ville ». Il produit aussi des complexes architecturaux à destination neutre de toute vie « qui reste », tels les Data centers, les infrastructures logistiques et les aéroports. Aerotropolis serait le nom de la ville repensée à l’échelle globale de l’infrastructure logistique devenue essence du monde. Il sera alors très difficile de pallier l’absence généralisée de relations humaines dans un univers aseptisé de la transaction de marchandises.
Parce que l’inhabitable désigne, pour celui qui en éprouve l’insoutenable isolement, une faille anthropologique, il n’est pas étonnant que s’y joue aussi la partition d’avec l’animalité (Mirru Kim encore), jusque dans les utopies architecturales. L’effet dystopique de cette condition humaine altérée se retrouve aussi dans le spectre très occidental de Garbage City, que l’on prétend revisiter toujours, depuis que l’homme est homme et qu’il y a eu Job sur son tas de fumier. Les arts recyclent parfois des monceaux d’ordure…
Il y a une part de sidération dans la contemplation de la marche de la ville contemporaine qui le dispute à une certaine angoisse vis-à-vis de l’horizon. Le dégout de la ville, le rejet épileptique à son endroit, comme s’il s’agissait d’une catastrophe verticale, viennent en partie de ce que le monde est perçu, à travers elle, comme de moins en moins habitable. Allons-nous nous décider à prendre l’ascenseur pour la Lune ? Le réchauffement climatique va-t-il faire monter nos maisons sur des échasses ? N’a-t-on pas comme une envie de s’arracher de la terre que nous meurtrissons ?
« À son terme logique, la globalisation, – l’extension à la terre entière du Marché de la marchandise qui se substitue au monde où les hommes séjournent auprès des choses – exproprie l’habitation même. Le capitalisme arrivé à son stade présent de financiarisation généralisée ne se contente pas d’exploiter le prolétariat mondial par l’extension de la plus-value, d’opprimer et de mettre en servitude des millions de nouveaux esclaves de la mondialisation, il s’attaque maintenant à l’existence même de l’humanité privée désormais de l’habitation, c’est-à-dire confrontée à la disparition du monde en proie à l’im-monde. »[3] Au musée des utopies devrons nous ranger la quasi naturalité que le verbe « habiter » enveloppe ? Je me demande de quoi aura l’air notre avant-dernier retranchement de vie, celui d’avant la tombe. Habiter l’avenir est une forme de tension ontologique que la catastrophe met en faillite. Et dans un cabanon face à la mer, comme Le Corbusier, je songe aux cabanes qu’on détruit en France pour vice de conformité sociale.
La semaine dernière, parmi les beaux liens urbains, il y avait aussi…
The National Library of Minsk http://ow.ly/4hMdX // Dans la plus grande mosquée d’Europe, toute en arabesques (et avec un aspirateur) http://ow.ly/4hMbl // Piquer une tête sur le toit-terrasse de la Cité Radieuse de Marseille http://ow.ly/4erdo // Consultez la thèse de James Stirling en ligne http://ow.ly/4ercJ // De quelques monuments publics qu’on enferme http://ow.ly/4feuN Gated public spaces? // Rohrschach city http://ow.ly/4erbS // Soundwalks, audio walks, marches d’écoutes et balades sonores: une analyse des pratiques http://ow.ly/4er0U // L’espace disciplinaire est une invention des villes http://ow.ly/4eqZD // Alors, ça dépasse tout de même Georges Bataille au pays du « LOL urbain » http://ow.ly/4eqYU // À télécharger de toute urgence: Le poème de l’angle Droit de Le Corbusier http://ow.ly/4dOiZ [FR&ESP&ENG] // Quand un fabriquant de pompes inventait des villes: Bata http://ow.ly/4hMpz // Brooklyn Bridge, histoire d’un signal urbain http://ow.ly/4hMGI // « Le conflit d’angle de l’ordre Dorique » selon Anselm Kiefer http://ow.ly/4hMHq
***
[1] Bernard-Marie Koltès, Le retour au désert, Éditions de Minuit, 1988, p.57.
[2] Joy Sorman et Éric Lapierre, L’inhabitable, Éditions Alternatives & Pavillon de l’Arsenal, janvier 2011.
[3] Jean-Paul Dollé, L’inhabitable capital, Éditions Lignes, 2010.









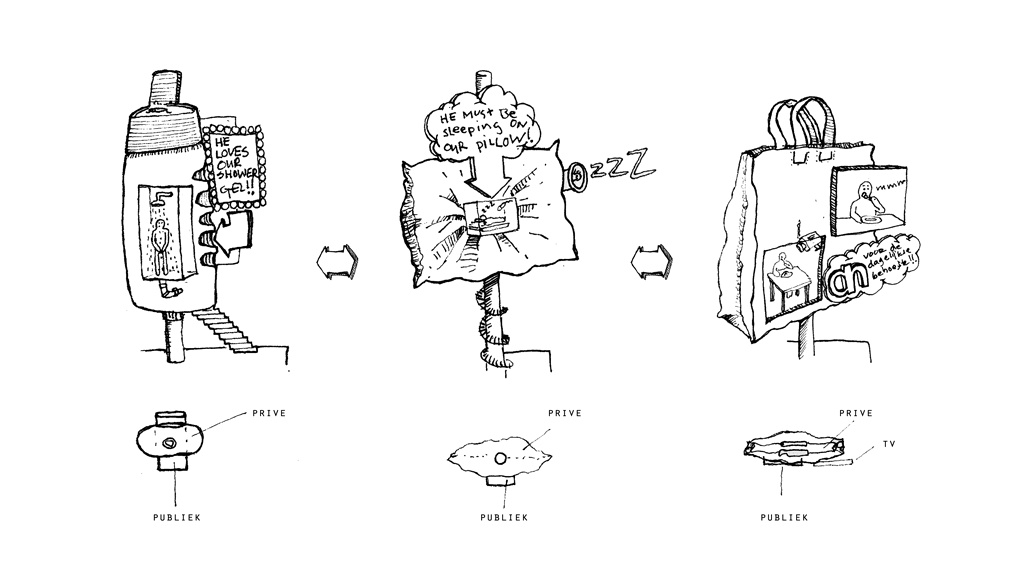





Pas encore de commentaire