L’espace public d’Istanbul entre chats et chiens

Lorsque le brouillard se lèverait, Istanbul lui tendrait la main. Une lumière d’un blanc immaculé s’étendrait d’abord sur le rivage puis sur les arbres des collines. Les chats se réveilleraient avec le premier appel à la prière, les mouettes commenceraient à battre des ailes et les macareux à tourner au-dessus des yachts ancrés au large. Une bande de vanneaux surgirait et survolerait la mer. Des chiens errants entreprendraient leur promenade matinale sans inspecter les poubelles.
Nedim Gürsel [1]
Ce sont les millionnaires silencieux. Les habitants les nourrissent. On respecte leurs congrégations nocturnes. Certains quartiers, comme Cihangir, leur construisent des abris, parfois sophistiqués. Ils sont souvent grimés dans les graffitis. Des coupelles d’eau s’amoncèlent à tous les coins de rue en été… et surtout à côté de l’emmarchement de quelque magasin qui saura bénéficier de l’attrait pour sa clientèle du spectacle de félins se désaltérant. Qui pour ignorer qu’à Istanbul, les chats des rues sont rois ? L’industrie turque du tourisme connaît l’atout que représente cette spécificité stambouliote érigée en art de vivre. Tout visiteur qui se respecte — même Obama — revient en effet d’Istanbul avec une dizaine de photographies de chat des rues.
Le chat, animal pur, faisant « partie de la foi » selon le dire du Prophète, jouit de davantage de privilèges que le chien, et c’est depuis toujours. À Constantinople, rapporte Reşat Ekrem Koçu dans l’İstanbul Ansiklopedisi, on raillait les Roms qui laissaient entrer les chiens chez eux, Ô bizarrerie ! Le chien est en effet un animal impur en Islam. Sauf que les stambouliotes ont de longue date adopté une certaine tolérance vis-à-vis de ces chiens « des rues » (et pas « errants »), souvent « aussi débonnaires que les musulmans qui les laissent vivre » (Pierre Loti) : chiens utiles qui nettoient la voirie de ses ordures, secondent les gardiens de parking et donnent l’alerte en cas d’incendie…[2]

Le sort fait aux chiens
À mesure toutefois que l’approche hygiénique de l’espace public renouvelle ses méthodes à Istanbul, le chien de rue fait l’objet de débats sur son sort, auxquels le chat demeure souverainement étranger. Les légendes urbaines qui présentent le chien errant comme dangereux sont légions. On se raconte des histoires de pique-nique du dimanche abandonné en catastrophe, les grillades laissées à une horde de chiens affamés. Dans les nouveaux quartiers fermés de périphérie, où l’on croit s’être soustrait à la ville et à sa gestion « anarchique » de l’espace public — par exemple à Ataşehir (littéralement, « au-dessus de la ville ») ou à Yeni Dünya (littéralement, « le nouveau monde ») —, on craint que les meutes de chiens errants ne transmettent la rage aux animaux domestiques. On colporte aussi que dans la forêt de Beykoz, tout au nord de la partie asiatique de l’aire urbaine d’Istanbul, seraient « déportés » par la fourrière des milliers de chiens livrés à eux-mêmes. Certes, la loi de protection des animaux de 2004 dispose que les animaux errants doivent être stérilisés avant d’être relâchés. Mais les opérations de stérilisation en masse font l’objet de controverses entre les autorités et les associations de protection des animaux, car étant déléguées à des entreprises privées, on soupçonne ces dernières d’abattage discret (elles n’ont qu’à faire état comptable des organes prélevés pour être payées). Sans parler des empoisonnements qu’orchestrent au grand jour certaines municipalités, voire le centre ville d’Istanbul, comme en 1996 pour la préparation de la conférence internationale Habitat-II…
En arrière fond de ce faisceau de représentations sur le chien stambouliote, il y a un passif historique qui explique bien des choses. En 1910, le sultanat de Mehmed V prend la lourde décision de déporter pas moins de 30.000 chiens sur un îlot de l’archipel des îles aux Princes de la mer de Marmara. Un simple bout de rocher violet où les canidés vont s’entre-dévorer jusqu’au dernier… Cette histoire nourrit l’imaginaire stambouliote, d’autant qu’elle est symbolique des exactions perpétrées par le régime « Jeune-Turc » à l’encontre des minorités arménienne, grecque ou chrétienne.
Preuve s’il en est que le rapport public à l’animal dénote les attributs culturels, voire les impensés d’une société. Il n’y a jamais eu de population « invisible » du point de vue du pouvoir ; tout simplement parce que le pouvoir consiste en la mise en œuvre de dispositifs de visibilité et d’énonciation de ses sujets, fussent-ils des chiens.
Entre chats et chiens : éthique de la relation
Si le gouvernement urbain crée ou avalise une question des chiens, cette « publicité » même du débat sur l’animal légitime que ce dernier ait un statut dans la République, voire une voix à part entière. De longue date, encore, on trouve au sujet des chiens d’Istanbul des qualificatifs politiques. « Les chiens sont en révolution dans le quartier de Galata, écrit Loti, et poussent là-bas des hurlements lamentables. Ceux de mon quartier gardent la neutralité et je leur en sais gré ; ils dorment en monceaux devant ma porte. »[3] « Ils sont organisés en république fédérale », remarque un autre.[4] « C’est là le second peuple de la ville », dit Edmondo de Amicis.[5]
Mon hypothèse est que cette politique de l’animal se trouve fondée dans une éthique à l’œuvre au cœur de l’espace public stambouliote. Partant, cet espace public, peuplé de non humains qui ont des droits, se différencie de celui que l’Europe a hérité de la doctrine rationaliste de ses rois bâtisseurs de villes.

Il faut savoir qu’il n’y a pas ou peu de places à l’européenne à Istanbul, c’est-à-dire au sens d’un espace ouvert et ordonné dont la gestion municipale aurait défini la mise en scène architecturale et urbaine. L’espace public (« kamu mekânı » en Turc) — je veux dire celui qui n’est pas feint par quelque médiocre plan urbanistique — y est souvent ambigu, interstitiel et à la frontière de démarcations assez violentes, barrières et barbelés de tout genre. Mais pardessus tout, cet espace est associé à la « plaisance », à la jouissance d’une liberté de rapports interpersonnels dans un espace non privatisé par la police ou les promoteurs, les deux agents du néo-libéralisme urbain. Le public, c’est ce qui n’a pas encore été exproprié…
Or, la présence des chiens et des chats est de nature à étendre cette notion de plaisance à certains espaces, fonctionnels et délimités par la gouvernance locale, à savoir la rue et la parcelle foncière libre pour l’essentiel. Prenons le trottoir — espace de déambulation propre, sécurisé et réglé, au service du piéton et signe traditionnel d’aménité d’une rue. Il est à Istanbul régulièrement occupé par des êtres vivants qui s’y attachent, y vivent et à l’égard desquels un rapport de courtoisie est presque nécessairement engagé. Mais les pratiques attentionnées à l’égard des animaux de rue, comme le fait de les nourrir en rapport de « bon voisinage » engagent aussi une forme d’éthique quant à l’usage partagé de l’espace. Je pense qu’une portion de la rue passant ainsi sous le contrôle d’un habitant « attentionné » échappe dès lors en partie au domaine public et devient une extension de l’habitat, un peu comme la horma dans la tradition musulmane (c’est-à-dire l’extension, dehors, des tenants et aboutissants de la maison). Ce curieux retournement, pris à l’échelle d’un quartier, est de nature à créer des « villages dans la ville ».
D’un côté, l’attachement à l’animal ne procède pas de l’affirmation d’une propriété sur lui. De l’autre, ces preuves d’attention à l’étranger familier — caresses, nourriture, logis de fortune — comportent une part d’annexion de l’espace de la rue à l’accomplissement d’une tâche intime, mais socialisée. Il existe plein d’histoires sur des citoyens qui vont jusqu’à récupérer à la fourrière un chien qui ne leur appartient pas, mais qui appartient à ce coin de rue-ci, à ce kiosque-là, comme un voisin ivrogne qu’on irait chercher en cellule de dégrisement. Par ailleurs, les animaux des rues, chats et chiens confondus, servent évidemment de médiation entre plusieurs couches sociales, y compris sous l’angle de l’affrontement idéologique…

Pour emprunter le vocabulaire d’Edward T. Hall, la « bonne distance », sociale et personnelle, s’établit ainsi dans un « chez-soi » à forme ouverte et partagée, non pas à « tout le monde » — comme le voudrait une acception répandue de la notion d’espace public —, mais plutôt à la communauté éthique de ceux qui respectent les bêtes. C’est donc à un régime d’engagement particulier que ce type d’espace commun qu’est la rue peuplée de chats et de chiens doit sa « publicité ». Il n’y a pas de règle générale ou de morale sous laquelle subsumer le comportement des stambouliotes à l’égard des animaux. Ils ne réfèrent pas leur conduite à l’obligation morale, et leurs attentions ne sont pas nécessairement constantes ni intemporelles. Et c’est parce que l’éthique divise et partage davantage qu’elle ne crée le consensus d’injonction de l’ordre moral, que les débats au sujet des chiens et des chats d’Istanbul dans l’espace public demeureront vifs.
Texte initialement écrit dans le cadre du projet des vases communicants, et auquel répond l’article d’Aymeric Bôle-Richard, « Les chats de Galata« .
[1] Nedim Gürsel, Resimli Dünya, 2004, chapitre 12.
[2] « On me dit que votre nombre diminue. Tant pis ! Vous êtes le grand égout collecteur qui absorbe et qui triture toutes les immondices jetées sur la voie publique. Votre estomac, toujours vide et avide, dévore ce qui tombe des fenêtres et des hottes, et c’est vous, vous et les larges brises qui vont de la Marmara à la mer Noire, qui avez, plus d’une fois, sauvé de la peste la grande Byzance et les kiosques perdus dans les replis verdoyants de ses collines ombreuses. On en trouve pourtant encore des milliers et des milliers, dans les rues les mieux habitées comme dans les ruelles les plus obscures. Il y en a des grappes dans le quartier juif et sur la route de Besseli. Toujours les mêmes : jaunes, pareils au renard, avec le museau pointu, les oreilles en l’air, la queue traînante et les cuisses efflanquées. Leur race ne change jamais » (Adolphe Opper de Blowitz, Une course à Constantinople, Éditions Plon, 1884).
[3] Pierre Loti, Aziyadé, chap. 2, VII.
[4] Gaston Deschamps, À Constantinople, Éditions Calmann-Lévy, 1913.
[5] Edmondo De Amicis, Constantinopoli, 1878.






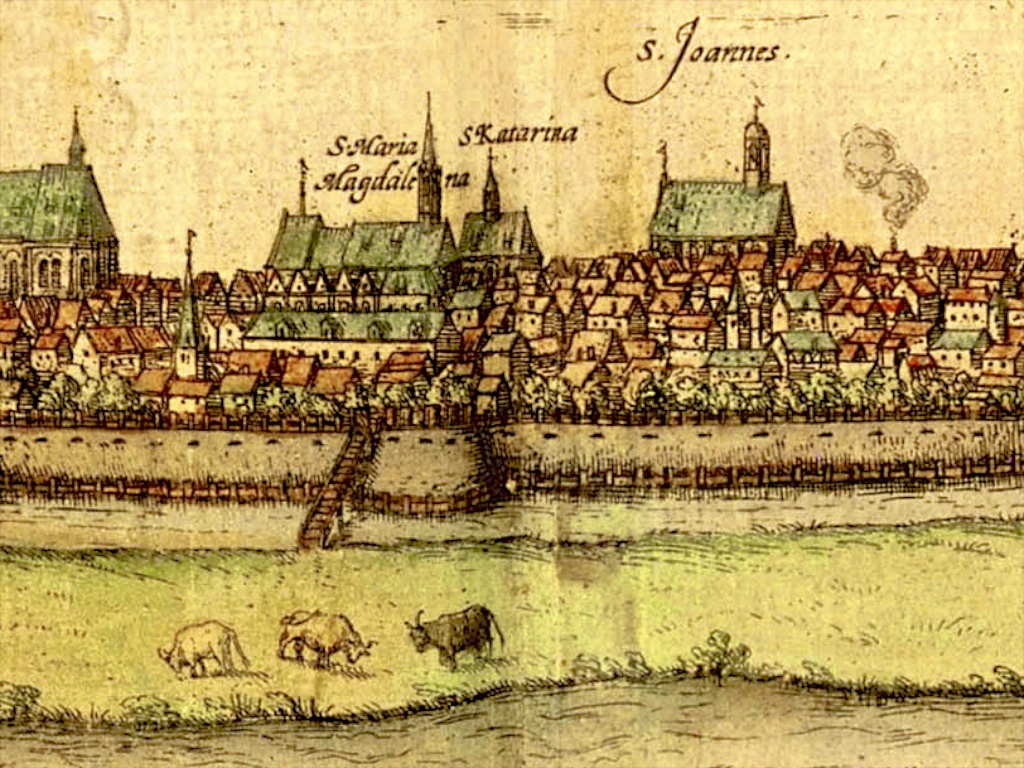
Pas encore de commentaire